Eric Dufour
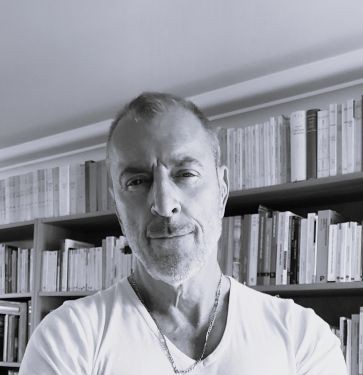
Eric Dufour
17 juin 2025 Commentaires fermés sur Eric Dufour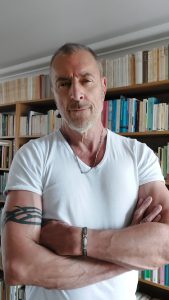
Eric Dufour est professeur de philosophie à l’Université Paris Cité. Il est membre du CANTHEL depuis juin 2025, après avoir été directeur du LCSP (Laboratoire de Changement Social et Politique). Il a été professeur à l’Université de Grenoble Alpes, et, avant, Maître de Conférence à l’Université de Toulouse Capitole. Auparavant, il a été vingt ans professeur agrégé de philosophie en lycée, à Cherbourg, Evreux, Vire, Drancy, Saint-Denis et Montereau-Fault-Yonne. Lauréat de l’Institut Universitaire de France (Senior, chaire fondamentale, promotion 2024), il développe un programme de recherche sur la question sociale et le cinéma à travers une approche de philosophie sociale. Il a fondé et dirige la collection « Philosophie et cinéma » chez Vrin
Ses recherches portent d’abord sur la théorie de la connaissance dans la philosophie allemande du XIXe siècle, depuis Kant (trois articles dans les Kantstudien) jusqu’aux néokantisme (de Marbourg et de Heidelberg) (Hermann Cohen aux PUF, Les Néokantiens chez Vrin, Paul Natorp chez Vrin), en passant par Nietzsche (Leçons sur Nietzsche héritier de Kant, Ellipses). Et elles portent également sur les questions de philosophie de l’art, particulièrement la musique et la musique chez Nietzsche (Qu’est-ce que la musique ? chez Vrin, L’Esthétique musicale de Nietzsche au Septentrion).
Son travail s’est élargi aux questions des rapports entre les sphères en philosophie et de là à la philosophie sociale (Qu’est-ce que la critique sociale ? chez Hermann, Bruno Bauer et les Jeunes Hégéliens chez Vrin). Elle s’est également étendue au cinéma (Le Cinéma d’horreur et ses figures aux PUF, Le Mal dans le cinéma allemand chez Armand Colin, Le cinéma de science-fiction et son histoire chez Armand Colin, La Valeur d’un film chez Armand Colin).
théorie de la connaissance / philosophie sociale / cinéma / esthétique / philosophie de l’art
RECHERCHES
Théorie de la connaissance
Cet axe de recherche met au jour les analyses des processus cognitifs qui ont été développés, d’abord par Kant, ensuite dans des philosophies issues du kantisme, au premier chef les différentes écoles néokantiennes, mais aussi dans la philosophie de Nietzsche, où l’on trouve toute une analyse généalogique des mécanismes par lesquels se constitue la connaissance humaine. Dans tous les cas, on trouve une analyse de la perception et de ses rapports entre la signification (pensée prédicative et pensée antéprédicative).
Esthétique musicale
Cet axe de recherche porte sur la question du sens de la musique, essentiellement à travers les analyses qu’on trouve chez Nietzsche (L’Esthétique musicale de Nietzsche, Septentrion). Quel est le sens de la musique ? La musique a-t-elle une signification extra-musicale ? En quel sens la musique signifie-t-elle ? (Qu’est-ce que la musique ?, Vrin) Et le(s) sens qu’on confère à la musique ne proviennent-ils pas d’une certaine pratique sociale de la musique qui détermine, précisément le sens qu’on lui confère ? (C’est là toute la thèse de l’essai « Qu’est-ce qu’une conception sociale de la musique ? (Adorno, la musique, l’Allemagne) » (Philosophie n° 142, juin 2019).
Philosophie sociale
Comment et en quoi les processus d’apprentissage et d’acquisition de la connaissance sont-ils conditionnés par la situation sociale de l’individu ? Cette question apparaissait déjà chez Nietzsche (Leçons sur Nietzsche. Héritier de Kant, Ellipses), et elle trouve son assomption dans ce qu’on nomme l’« épistémologie des points de vue » (Qu’est-ce que la critique sociale ?, Hermann). S’il n’y a pas de théorie de la connaissance autonome, mais que toute philosophie de la connaissance se trouve absorbée par une philosophie sociale, c’est parce que, comme le développe la Théorie critique (Horkheimer), toute connaissance a une origine sociale et y retourne, c’est-à-dire produit un effet social.
Théorie du cinéma et histoire du cinéma
Mes recherches sur le cinéma portent autant sur le cinéma d’horreur (Le Cinéma d’horreur et ses figures, PUF), que sur le cinéma allemand (dont j’ai retracé l’histoire en prenant le mal comme fil directeur dans Le Mal dans le cinéma allemand, Armand Colin) ou bien le cinéma de science-fiction (Le Cinéma de science-fiction. Histoire et philosophie, Armand Colin). J’ai aussi publié un livre sur David Lynch (David Lynch : image, matière et temps) et sur Woody Allen (Dans la tête de Woody Allen. Le cinéma, Dieu, le sexe et le reste, Armand Colin). Plus largement, j’ai travaillé sur le sens de l’image cinématographique (Qu’est-ce que le cinéma ?, Vrin) et la question de la réception ou de l’usage (La Valeur d’un film. Philosophie du beau au cinéma, Armand Colin).
FORMATION
| Depuis septembre 2014 |
Professeur des Universités en philosophie (Université de Paris Cité).
|
| 2008-2014
|
Professeur des Universités en philosophie, Université Pierre Mendès France (Grenoble 2)
|
| 2003-2008 | Maître de conférence en philosophie, Université du Mirail (Toulouse)
|
| 2000-2003 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée Paul Eluard (Saint-Denis, 93)
|
| 1999-2003 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée Eugène Delacroix (Drancy, 93)
|
| 1994-1999 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée Aristide Briand (Evreux, 27)
|
| 1992-1994 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée technique Modeste Leroy (Evreux, 27)
|
| 1990-1992 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée technique A. de Tocqueville (Cherbourg, 50)
|
| 1989-1990 | Professeur agrégé de philosophie, Lycée Marie Curie (Vire, 14)
|
| 1988-1989 | Stage de capes au lycée F. de Malherbe (Caen, 14)
|
| 1985-1988 | Maître-auxiliaire dans l’académie de Rennes
|
PUBLICATIONS
I.Ouvrages
A) Esthétique, cinéma, musique
Ouvrages
| 1 | Naissance d’un cinéma africain : Jean Rouch versus Ousmane Sembène, Paris, Vrin, 2025
Ce travail porte sur l’émergence, d’abord avec Rouch à la fin des années 1950 puis avec Sembène dans les années 1960, d’une image authentique des Africains qui soient débarrassées des présupposés axiologiques véhiculés par la colonisation.
|
| 2 | 100 films de science-fiction, Paris, Larousse, 2023
Ce livre illustré se propose de présenter les 100 plus grands films de science-fiction qui ont marqué le genre par leur qualité cinématographique qui relève tout autant de l’image que de l’histoire mise en œuvre par le récit.
|
| 3 | Dans la tête de Woody Allen. Le cinéma, Dieu, le sexe et le reste, Paris, Armand Colin, octobre 2017
Ce livre porte sur l’œuvre de W. Allen et analyse le contenu (sous-texte politique et social) en rapport avec la forme qui l’exprime. Il fait apparaître un W. Allen libertaire et souligne les caractéristiques stylistiques propres à sa manière de filmer.
|
| 4 | La Valeur d’un film. Philosophie du beau au cinéma, Paris, Armand Colin, 2015
Ce travail d’esthétique appliquée fait une typologie de toutes les positions qui ont été soutenues sur la question des critères d’appréciation d’un film (position esthétique ou formaliste, position politique ou contenuiste, etc.). Il propose en outre une thèse inédite sur la question.
|
| 5 | Qu’est-ce que le mal, Monsieur Haneke ?, Paris, Vrin, 2014
Ce travail est une analyse de l’œuvre cinématographique du cinéaste Michael Haneke, qui met à jour les constantes thématiques (la critique sociale dans ses différentes dimensions, la distanciation et l’autoréférence) et stylistiques (le long plan fixe, le rôle du hors champ, le statut de la musique, etc.).
|
|
6 |
Le Mal dans le cinéma allemand, Paris, Armand Colin, 2014
Ce livre est une histoire du cinéma allemand, depuis l’expressionnisme jusqu’à aujourd’hui, à l’aune du concept du mal. Il décline en somme les figurations du mal dans ce cinéma, en montrant la manière dont, d’une part, cet art incorpore et exprime les préoccupations des autres formes culturelles sédimentées dans l’histoire de l’Allemagne (philosophie, poésie, littérature, musique) ; et, d’autre part, comment l’histoire du cinéma allemand du xxe siècle reflète, telle la monade leibinizienne, l’histoire de l’Allemagne.
|
| 7 | Le Cinéma de science-fiction : histoire et philosophie, Paris, Armand Colin, 2011
Ce livre renferme d’abord une partie historique où on montre la manière dont la S-F se constitue comme genre à part entière dans le cinéma américain classique, puis se développe dans les autres pays avec, à chaque fois, une physionomie propre. Il contient ensuite une partie plus philosophique, qui met en évidence ce que véhiculent ou impliquent les constructions narratives et les figures stylistiques (i.e. l’utilisation du montage et la construction du plan) du point de vue esthétique, métaphysique, politique et social.
|
| 8 | Les Monstres au cinéma, Paris, Armand Colin, 2009
Ce travail est une typologie des différents types de monstruosité, qui porte aussi sur la question du critère permettant d’établir cette typologie, d’une part, et, d’autre part, il tente de montrer quels sont les moyens du cinéma pour présentifier ces types de monstruosité (à savoir la monstration ou figuration, la suggestion et l’expression).
|
| 9 | Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Vrin, 2009
Ce texte traite, d’abord, la question de savoir si le cinéma est un langage (polémique Metz-Deleuze), et ensuite celle de comprendre la spécificité du médium cinématographique (qu’est-ce que raconter par des moyens proprement cinématographiques une histoire ?).
|
| 10 | David Lynch : image, matière et temps, Paris, Vrin, 2008 ; réédition en 2020 avec une Postface inédite de 20 pages sur Twin Peaks saison 3.
Il s’agit de mettre en évidence les constantes thématiques et, surtout, stylistiques de l’œuvre du cinéaste David Lynch, au sein d’une approche qui n’est pas historique mais proprement esthétique, et qui par ailleurs analyse la manière singulière dont ce cinéaste utilise le rapport entre son et image.
|
| 11 | Le Cinéma d’horreur et ses figures, Paris, P.U.F., 2006
Ce livre, qui n’est pas historique, tente, en premier lieu, de distinguer le cinéma d’horreur du cinéma fantastique, et, en second lieu, de proposer une classification, non pas des thèmes, mais des figures stylistiques, donc proprement audiovisuelles, qu’on trouve dans le cinéma d’horreur.
|
| 12 | Qu’est-ce que la musique ?, Paris, Vrin, 2005
Cet essai s’articule autour de la question de savoir si la musique représente ou exprime quelque chose, et fait une histoire de la question (du romantisme allemand jusqu’à la sémantique de Nattiez en passant par l’esthétique formaliste). Il aboutit du coup à la question de savoir ce qu’est un discours légitime sur la musique, essentiellement traitée à travers un texte de Wittgenstein.
|
| 13 | L’Esthétique musicale de Nietzsche, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2005
Cet ouvrage, dont certains chapitres proviennent d’articles antérieurs remaniés, propose une vue systématique sur la question « Nietzsche et la musique », en donnant une généalogie à cette question (importance du romantisme allemand), en montrant la périodisation de la pensée de Nietzsche (et aussi le fait que la réponse à la question dépend de choix philosophiques fondamentaux) et, enfin, en montrant le rapport entre ce que Nietzsche dit de la musique et la musique qu’il fait.
|
Ouvrages écrits en collaboration
| 1 | Analyse d’une œuvre : « Fenêtre sur cour » (A. Hitchcock, 1954), en collaboration avec L. Jullier, Paris, Vrin, 2019
|
| 2 | Analyse d’une œuvre : « Mort à Venise » (L. Visconti, 1971), en collaboration avec L. Jullier, Paris, Vrin, 2018
|
| 3 | Analyse d’une œuvre : « Lola Montès » (M. Ophuls, 1955), en collaboration avec J. Servois (dir.) et L. Jullier, Paris, Vrin, 2011
|
| 4 | Analyse d’une œuvre : « Casque d’or » (J. Becker, 1952), en collaboration avec L. Jullier, Paris, Vrin, 2009
|
| 5 | Analyse d’une œuvre : « L’homme à la caméra » (D. Vertov, 1929), en collaboration avec J.J. Marimbert (dir.) et L. Jullier, Paris, Vrin, 2009 |
| 6 | Analyse d’une œuvre : « La mort aux trousses » (A. Hitchcock, 1959), en collaboration avec J.J. Marimbert (dir.), L. Jullier et J. Servois, Paris, Vrin, 2008 |
Tous ces travaux qui relèvent d’une collaboration entre philosophes et théoriciens du cinéma entrent dans l’esthétique appliquée, puisqu’ils cherchent à saisir, à l’aune d’analyses du fonctionnement du récit c’est-à-dire de l’organisation des images (point de vue, échelle, raccord, etc.), comment est construit un film singulier. En outre, le film est à chaque fois mis en rapport avec l’œuvre du cinéaste (d’où la question du style) et avec le contexte historique et culturel dans lequel l’œuvre est produite.
Direction d’ouvrages
| 1 | Le National-socialisme dans son cinéma, revue de l’Institut des Langes et des Cultures d’Europe et d’Amérique (ILCEA, E.A. 613), co-dirigé avec F. Genton, juin 2015 (https://ilcea.revues.org/3289).
Cet ouvrage (actes d’un colloque fait à Grenoble en 2013) fait le point sur le cinéma nazi et sur les lectures qui en ont été faites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il insiste particulièrement sur la question du rapport entre le divertissement et la propagande.
|
| 2 | Une anthologie du rythme, direction du volume en collaboration avec G. Mathon, Filigrane n° 8, 2009
Cet ouvrage tente de faire le point sur la question du rythme musical en systématisant, grâce aux contributions de chercheurs venus de différents horizons et s’intéressant à la musique dans sa diversité, les différentes questions qui ont pu être posées à ce sujet.
|
B) Philosophie allemande
Ouvrages
| 1 | Qu’est-ce que la critique sociale ?, Paris, Hermann, 2023
Ce livre tente de faire le tour de questions d’ordre méthodologique qui surgissent dès qu’il est question de critique sociale aujourd’hui. Il fait le point sur ce qu’on entend par cette expression, et tente, pour les différentes questions, de faire leur généalogie tout en montrant concrètement comment elles se posent dans la société actuelle. |
| 2 | Bruno Bauer et les Jeunes Hégéliens. Aux origines de la critique politique et sociale, Paris, Vrin, 2023
Ce livre est consacré à Bruno Bauer et à la manière dont celui-ci développe toute une critique sociale qui est en même temps une critique économique, politique et culturelle – et, en même temps, analyse les conditions de possibilité d’une critique sociale. Ce faisant, on montre la proximité, avant la scission, du jeune Marx avec Bauer.
|
| 3 | Leçons sur Nietzsche, héritier de Kant, Paris, Ellipses, 2015
Il s’agit de la réécriture totale de ma thèse, 20 ans après et à l’aune de tous les travaux effectués depuis sur Nietzsche et surtout sur le néokantisme. J’y montre que la philosophie nietzschéenne est une philosophe du sens et nullement une philosophie de la vie, et comment Nietzsche peut être interprété comme un philosophe postkantien. Le soupçon nietzschéen m’apparaît comme un achèvement possible de la critique kantienne, et j’établis en outre des rapports entre ce que dit Nietzsche et la philosophie de Natorp. |
| 4 | La Philosophie sociale de Paul Natorp, écrit en collaboration avec J. Servois, Paris, Vrin, 2015
Il s’agit à la fois de mettre en évidence la généalogie de l’expression de « philosophie sociale » dans la philosophie allemande du xixe siècle, et le sens que revêt cette expression dans le néokantisme de Marbourg et plus précisément chez Natorp. Celui-ci prétend en effet, avec sa philosophie sociale qu’il s’agit de décrire en détail et qui est construite en rapport avec une réflexion sur les questions politiques et sociales qui lui sont contemporaines, achever la philosophie pratique de Kant.
|
| 5 | Paul Natorp : de la « Psychologie générale » à la « Systématique philosophique », Paris, Vrin, 2010
Cet essai montre comment Natorp, à l’époque marbourgeoise, élabore une théorie du sujet connaissant qui anticipe à bien des égards la phénoménologie husserlienne, puis la manière dont le philosophe sort des limites du néokantisme de Marbourg pour, à la fin de sa vie, instaurer un questionnement philosophique plus fondamental et originaire qui, anticipant cette fois l’entreprise heideggérienne, en revient contre la philosophie moderne à la question de l’être.
|
| 6 | Les Néokantiens, Paris, Vrin, 2003
Ce livre détermine ce qu’est le néokantisme, à la fois historiquement et philosophiquement, met en évidence la spécificité des deux écoles rivales, celle de Marbourg et celle de Heidelberg, et, enfin, montre la spécificité de la position de chacun des trois grands représentants de chaque école (Cohen, Natorp et Cassirer pour Marbourg ; Windelband, Rickert et Lask pour Heidelberg).
|
| 7 | Hermann Cohen : Introduction au néokantisme de Marbourg, Paris, P.U.F., 2001
Ce travail est une présentation systématique de la philosophie cohénienne, qui montre comment, après trois ouvrages qui commentent les trois Critiques kantiennes, Cohen veut construire une logique de la connaissance, une éthique et une esthétique qui dépassent et achèvent le système critique. Il tente enfin de mettre en évidence la manière dont l’unification du système est fondée dans une philosophie de la religion qui se substitue à une psychologie initialement prévue. |
Direction d’ouvrages
| 1 | Les Jeunes hégéliens, Les Études germaniques, n°3 (2023), direction du numéro en collaboration avec F. Fischbach.
Ce numéro des Etudes germaniques propose propose une mise au points sur les Jeunes hégéliens, à partir des études les plus récentes et des spécialistes internationaux.
|
C) Ouvrages pédagogiques
| 1 | La force de vivre tout en fiches, co-écrit avec J. Servois, Paris, Dunod, 2020.
Cet ouvrage de 500 000 caractères prépare l’épreuve de français/philosophie des classes préparatoires scientifiques, il est consacré au thème « la force de vivre » à travers les trois œuvres au programme, à savoir : Victor Hugo, Les Contemplations ; Nietzsche, Le gai savoir ; Alexievitch, La supplication.
|
| 2 | La Démocratie tout en fiches, co-écrit avec J. Servois, Paris, Dunod, 2019.
Cet ouvrage de 500 000 caractères prépare l’épreuve de français/philosophie des classes préparatoires scientifiques, il est consacré au thème « la démocratie » à travers les trois œuvres au programme, à savoir : Aristophane, Les Cavaliers et L’Assemblée des femmes ; Tocqueville, De la démocratie en Amérique ; Philip Roth, Le Complot contre l’Amérique.
|
| 3 | L’Amour tout en fiches, co-écrit avec J. Servois, Paris, Dunod, 2018.
Cet ouvrage de 400 000 caractères prépare l’épreuve de français/philosophie des classes préparatoires scientifiques, il est consacré au thème « l’amour », à travers les trois œuvres au programme, à savoir : Platon, Banquet ; Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été ; Stendhal, La Chartreuse de Parme.
|
II) Articles, contributions dans des ouvrages collectifs et introductions
A) Esthétique, cinéma, musique
Articles dans des revues à comité de lecture
| 1 | « La question sociale dans Stella Dallas (King Vidor, 1937) », Mises au point n° 14 (2021), (75 000 signes)
|
| 2 | « Qu’est-ce qu’une conception sociale de la musique ? (Adorno, la musique, l’Allemagne », Philosophie (Editions de Minuit), n° 142 (juin 2019) (95 000 signes)
|
| 3 | « Usage et expérience du film », Mise au point, 8 (2016), https://map.revues.org/2104
|
| 4 | « Ce que nous “dit” la musique. Conscience théorique et conscience esthétique », Kairos, 21 (2003)
|
| 5 | « La physiologie de la musique de Nietzsche », Nietzsche Studien, vol. 30 (2001)
|
| 6 | « Les lieder de Friedrich Nietzsche », Nietzsche Studien, vol. 28, 1999
|
| 7 | « L’esthétique musicale formaliste de Humain trop humain », Nietzsche Studien, vol. 28, 1999
|
| 8 | « Métaphysique de la musique dans Le Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer et dans La Naissance de la tragédie de Nietzsche », Les Études philosophiques, n° 4/1997 |
Contributions dans des ouvrages collectifs et introductions
| 1 | « Méduse et le cinéma », La figure de Méduse de la Grèce antique à l’époque contemporaine, Catalogue de l’exposition sur « La figure de Méduse de la Grèce antique à l’époque contemporaine » (MBA de Caen, printemps 2023), Paris, In Fine, 2023.
|
| 2 | « Le cinéma fantastique des années 70 à nos jours », article « Fantastique » dans l’Encyclopaedia Universalis, Universalia 2017
|
| 3 | « Une analyse de Heimkehr (G. Ucicky, 1941) », dans E. Dufour et F. Genton, Le National socialisme dans son cinéma, revue de l’Institut des Langes et des Cultures d’Europe et d’Amérique (ILCEA, E.A. 613), juin 2015, https://ilcea.revues.org/3393 |
| 4 | Introduction (en collaboration avec L. Jullier et A. Zielinska) à N. Carroll, Philosophie des films, trad. fr. E. Dufour, L. Jullier, J. Servois et A. Zielinska, Paris, Vrin, 2015
|
| 5 | « La représentation de la science dans le cinéma de science-fiction », dans J. Nacache (dir.), Cinéma et science, Alliage, n° 73 (2013)
|
| 6 | Article « Horreur (Cinéma d’horreur) » dans le Dictionnaire de la violence, dirigé par Michela Marzano, Paris, P.U.F., 2011
|
| 7 | « Le rythme musical » (écrit en collaboration avec G. Mathon), dans Musique et temps, Paris, Les éditions de la Cité de la musique, 2008
|
| 8 | « Qu’est-ce que le cinéma d’horreur ? », Puissance de l’image, textes rassemblés par J.C. Gens et P. Rodrigo, Editions Universitaires de Dijon, 2007
|
| 9 | « Schoenberg face aux problèmes de l’esthétique musicale », dans « C’est ainsi que l’on crée… ». À propos de « La Main heureuse » de Schoenberg, ouvrage sous la direction de J. Caullier, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2003
|
| 10 | « L’année 1872 de Nietzsche : La Naissance de la tragédie et Manfred Meditation », Nietzsche, sous la direction de M. Crépon, Les Cahiers de l’Herne, 2000 |
B) Philosophie allemande
Articles dans des revues à comité de lecture
| 1 | « La nation chez Bruno Bauer entre social et politique. Particulier, universel et singulier », Les Jeunes hégéliens, Les Études germaniques, n°3 (2023), direction du numéro en collaboration avec F. Fischbach.
|
| 2 | « Nietzsche and Kant. The Determination of Action », New Nietzsche Studies, The Journal of Nietzsche Society, vol. 9 (2014).
|
| 3 | « Sens et vie chez Nietzsche », Philosophie (Editions de Minuit), n° 95 (automne 2007)
|
| 4 | « Le statut de l’espace esthétique dans la philosophie kantienne », écrit en collaboration avec Julien Servois, Kant Studien, n° 96 (2005)
|
| 5 | « Remarques sur la note du paragraphe 26 de l’Analytique transcendantale : les interprétations de Cohen et de Heidegger », Kant Studien, 94 (2003)
|
| 6 | « Le statut du singulier : Kant et le néokantisme de l’école de Marbourg », Kant Studien, 93 (2002)
|
| 7 | « Le processus de formation des concepts dans la philosophie de Nietzsche », Philosophie (Editions de Minuit), n° 66, 2000 |
Contributions dans des ouvrages collectifs et introductions
| 1 | « L’histoire selon Natorp », Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukantianismus, sous la dir. de C. Krijnen et M. de Launay, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013 |
|
2 |
« La notion de philosophie sociale chez Natorp », Histoires et définitions de la philosophie sociale, sous la dir. de E. Dufour, F. Fischbach et E. Renault, Recherches sur la philosophie et le langage, n° 28 (2012)
|
| 3 | « Négation et altérité chez Hermann Cohen et Paul Natorp », Negation, Unendlichkeit und Andersheit im Neukantianismus, Actes du colloque de la Hermann Cohen Gesellschaft (fevrier 2004), sous la dir. de P. Fiorato, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2009
|
| 4 | « Descartes à Marbourg », Descartes en Kant, sous la dir. de M. Fichant et J.L. Marion, Paris, P.U.F., coll. Epiméthée, 2006
|
| 5 | « La philosophie de Wilhelm Windelband », Introduction à la traduction de W. Windelband, « Qu’est-ce que la philosophie ? » et autres textes, Paris, Vrin, 2002
|
| 6 | « Les trois éditions de La Théorie kantienne de l’expérience de Cohen », Avant-propos à la traduction de H. Cohen, La Théorie kantienne de l’expérience, Paris, Le Cerf, 2001
|
| 7 | « L’interprétation cohénienne de la Critique de la raison pure de Kant », Introduction à la traduction de H. Cohen, Commentaire de la « Critique de la raison pure » de Kant, Paris, Le Cerf, 2000
|
| 8 | Article « Néokantisme », Grand dictionnaire de la philosophie, sous la direction de M. Blay, Paris, A. Colin, 2002
|
| 9 | Notices sur H. Rickert (« Validité logique et validité éthique »), W. Windelband (« Méthode critique ou méthode génétique ? »), E. Cassirer (« Le problème du symbole et sa place dans le système de la philosophie »), P. Natorp (« Logique générale »), dans Néokantismes et théorie de la connaissance, sous la direction de M. de Launay, Paris, Vrin, 2000 |
Articles dans des revues sans comité de lecture
| 1 | « Itinéraire initiatique et éternel retour dans Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche », L’Enseignement philosophique, n° 5 (juin 2001) |
III. Traductions
A) Esthétique, cinéma, musique
| 1 | Traduction (en collaboration avec Laurent Jullier, Julien Servois et Anna Zielinska) de N. Carroll, Philosophie des films, Paris, Vrin, 2015.
|
B) Philosophie allemande
| 1 | Traduction (en collaboration avec P. Clochec) de R. Jaeggi, Critique des formes de vie, Paris, Vrin, 2025
|
| 2 | Traduction (en collaboration avec J. Servois) de P. Natorp, Psychologie générale, Paris, Vrin, 2008
|
| 3 | Traduction de W. Windelband, « Qu’est-ce que la philosophie ? », « Normes et lois de la nature », « Contribution à la théorie du jugement négatif », « Du système des catégories », « Philosophie de la culture et idéalisme transcendantal », « Logique », et Introduction de W. Windelband, « Qu’est-ce que la philosophie ? » et autres textes, Paris, Vrin, 2002
|
| 4 | Traduction (en collaboration avec J. Servois) et avant-propos de H. Cohen, La Théorie kantienne de l’expérience, Paris, Éditions du Cerf, 2001
|
| 5 | Traduction de E. Cassirer, « Le problème du symbole et sa place dans le système de la philosophie », et de P. Natorp, « Logique générale », dans Néokantismes et théorie de la connaissance, sous la direction de Marc de Launay, Paris, Vrin, 2000
|
| 6 | Traduction, introduction, annotation et index raisonné de H. Cohen, Commentaire de la « Critique de la raison pure » de Kant, Paris, Éditions du Cerf, 2000
|
| 7
|
Traduction en collaboration avec J. Servois de H. Holzhey, « Dieu et l’âme. Les rapports entre la critique de la métaphysique et la philosophie de la religion chez Hermann Cohen », Revue de métaphysique et de morale, n° 3/1998
|
